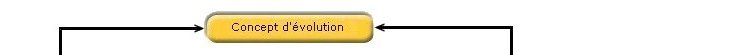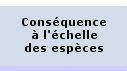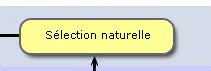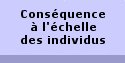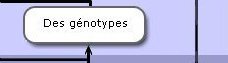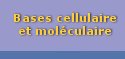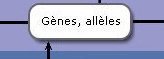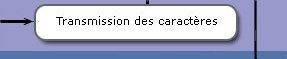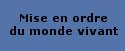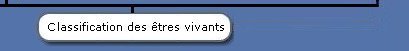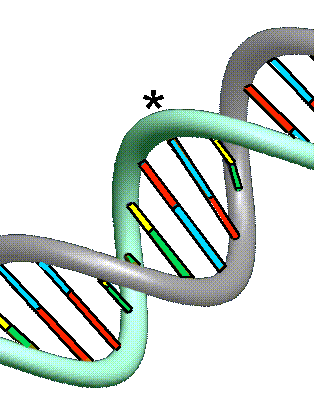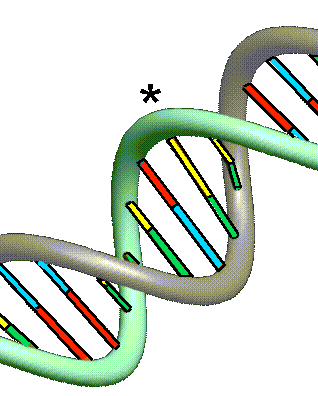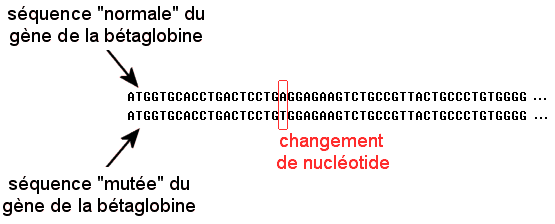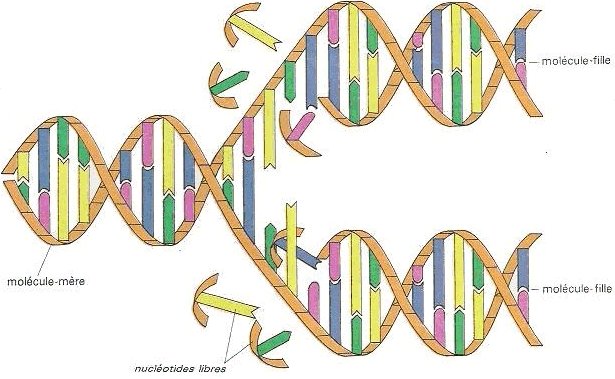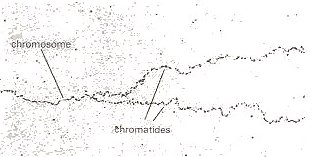Innovation génétique et complexification
du génome
 Quel est le moteur de l’évolution ? Quel est le moteur de l’évolution ?
Lamarck pensait que les êtres vivants
évoluaient en se transformant graduellement (conception gradualiste de
l’évolution) parce qu’ils s’adaptaient à leur environnement.
Ainsi les girafes ont un long cou parce qu’elles se sont
progressivement mises à manger les feuilles en haut des arbres. Lamarck
est à l’origine du concept d’évolution par adaptabilité autrement
déclinée par " la fonction créé l’organe ". Le
moteur de l’évolution est donc environnemental.
Darwin précise ce concept d’adaptabilité
avec la sélection naturelle. Il s’appuie sur les thèses
malthusiennes (économiste) en proposant que, non seulement l’organisme
doit s’adapter à son environnement, mais que l’environnement
sélectionne les individus les plus aptes.
Les découvertes successives en
génétique au cours du 20ième siècle ont montré qu’on
ne peut plus considérer l’environnement comme un moteur de l’évolution
mais plutôt comme un acteur qui arrive en fin de processus.
L’évolution des êtres vivants s’observe
par la diversité des êtres vivants, diversité qui est relative puisqu’à
pondérer avec les également nombreuses ressemblances entre les êtres
vivants. Comment proposer de nouvelles formes de vies à partir d’une
seule, sans intervention de l’environnement ?
 Les mutations permettent une innovation génétique
Les mutations permettent une innovation génétique
 Un changement de séquence dans un gène est appelé
mutation. Ce sont ces changements de séquence qui sont à l’origine
de la variabilité observée entre les êtres vivants. Un changement de séquence dans un gène est appelé
mutation. Ce sont ces changements de séquence qui sont à l’origine
de la variabilité observée entre les êtres vivants.
Les mutations se font au hasard : ce sont des
" accidents " qui se produisent de manière
aléatoire à certains moments de la vie cellulaire :
 Lors de la réplication de l’ADN avant que la cellule ne se divise en
deux cellules filles. L’ADN (c'est-à-dire le programme génétique) d’une
cellule de réplique (on pourrait faire l’analogie avec une
" photocopie ") de façon à ce que les deux
cellules filles héritent du même programme génétique que la cellule
mère dont elles sont issues. La copie n’est pas toujours parfaitement
identique à l’original. On compte, en moyenne une mutation pour un
million de réplications (mais ce taux est variable selon les
organismes). C’est dans cet unique cadre que l’environnement joue un
rôle : les agents mutagènes augmentent le taux de mutation de l’ADN
(mais il n’est pas responsable des mutations, il ne fait qu’amplifier
le phénomène).
Lors de la réplication de l’ADN avant que la cellule ne se divise en
deux cellules filles. L’ADN (c'est-à-dire le programme génétique) d’une
cellule de réplique (on pourrait faire l’analogie avec une
" photocopie ") de façon à ce que les deux
cellules filles héritent du même programme génétique que la cellule
mère dont elles sont issues. La copie n’est pas toujours parfaitement
identique à l’original. On compte, en moyenne une mutation pour un
million de réplications (mais ce taux est variable selon les
organismes). C’est dans cet unique cadre que l’environnement joue un
rôle : les agents mutagènes augmentent le taux de mutation de l’ADN
(mais il n’est pas responsable des mutations, il ne fait qu’amplifier
le phénomène).
|
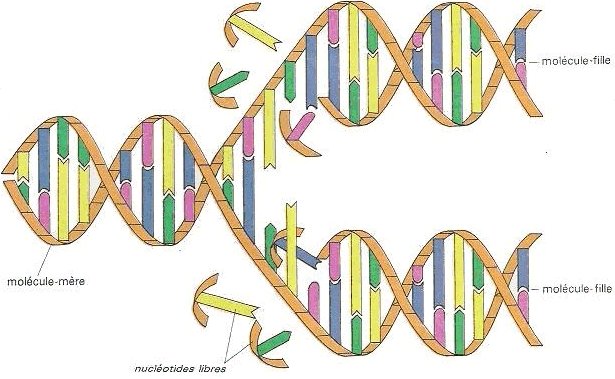
|
|
On voit sur l'électronographie de droite
(document obtenu en microscopie électronique) qu'un chromosome
(molécule d'ADN condensée) se réplique. Initialement constitué
d'une seule chromatide, il passe à deux chromatides qui sont
identiques en terme de séquence nucléotidique. Pour assurer
cette réplication à l'identique, les deux chaînes
complémentaires de l'ADN sont séparées puis servent, chacune
séparément, de modèle pour reconstituer deux brins d'ADN
complets. Toue cette opération se déroule avec l'intervention de
nombreuses enzymes. |
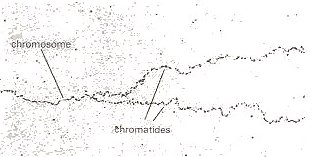 |
 Lorsque l’organisme est soumis à des radiations, l’environnement
est ici directement responsable des mutations qui n’auraient pas eu
lieu en absence de ce type de rayonnement. Le taux de mutation dû aux
divers types de rayonnement est difficilement quantifiable, surtout en
ce qui concerne le rayonnement " naturel " (en
dehors de la radioactivité issue de la technologie humaine).
Lorsque l’organisme est soumis à des radiations, l’environnement
est ici directement responsable des mutations qui n’auraient pas eu
lieu en absence de ce type de rayonnement. Le taux de mutation dû aux
divers types de rayonnement est difficilement quantifiable, surtout en
ce qui concerne le rayonnement " naturel " (en
dehors de la radioactivité issue de la technologie humaine).
 Les mutations ne
font pas apparaître de nouveaux gènes au sens strict du terme, mais de
nouvelles versions de ces gènes que l’on appelle allèles. Un gène
est en effet défini par une séquence particulière en nucléotides
mais également par sa position précise sur un chromosome (filament d’ADN
condensé). Donc deux séquences qui se trouvent à la même place, ou
même locus, sur deux chromosomes identiques, correspondent au même
gène .Si les deux séquences ne sont pas tout à fait identiques,
c’est qu’il s’agit de deux versions du même gène, de deux
allèles. Les mutations ne
font pas apparaître de nouveaux gènes au sens strict du terme, mais de
nouvelles versions de ces gènes que l’on appelle allèles. Un gène
est en effet défini par une séquence particulière en nucléotides
mais également par sa position précise sur un chromosome (filament d’ADN
condensé). Donc deux séquences qui se trouvent à la même place, ou
même locus, sur deux chromosomes identiques, correspondent au même
gène .Si les deux séquences ne sont pas tout à fait identiques,
c’est qu’il s’agit de deux versions du même gène, de deux
allèles.
Nouveau problème : si les mutations
font apparaître uniquement des nouvelles versions de gènes existants,
alors les mutations font apparaître de nouvelles caractéristiques chez
les individus d’une même espèce, mais pas d’espèce nouvelle. Cela
restreint les modalités de l’évolution. Comment apparaît une
nouvelle espèce ?
 Les duplications permettent une complexification des génomes
Les duplications permettent une complexification des génomes
La découverte de gènes différents (à des
positions différentes sur le(s) chromosome(s) ) mais aux séquences
très proches a permis de montrer que les gènes avaient la possibilité
de se dupliquer. Les mécanismes de duplication des gènes sont
maintenant connus (" accidents " de méiose…) :
on a ainsi mis en évidence plusieurs familles de gènes, tous
différents en terme de position sur le(s) chromosome(s), mais proches
en terme de séquence. On parle d’ailleurs de " familles
multigéniques " : tous les gènes d’une même famille
multigénique sont le résultat d’une histoire évolutive dans
laquelle, à partir d’un même gène ancestral (ou gène ancêtre)
sont apparus plusieurs autres gènes par des duplications successives.
Les gènes dupliqués évoluent alors indépendamment les uns des autres
en subissant des mutations au hasard (cela renforce d’ailleurs la
notion de hasard ou contingence puisque deux gènes ayant exactement les
mêmes séquences, dans une même cellule, subissent des mutations
différentes).
 Résumons Résumons
 Les mutations des gènes font apparaître de nouvelles versions de
ceux-ci : les allèles. On parle alors d’innovation génétique
Les mutations des gènes font apparaître de nouvelles versions de
ceux-ci : les allèles. On parle alors d’innovation génétique
 Les duplications des gènes font apparaître de
nouveaux gènes : des gènes dits homologues faisant partie d’une
famille multigénique. On parle alors de complexification des génomes. Les duplications des gènes font apparaître de
nouveaux gènes : des gènes dits homologues faisant partie d’une
famille multigénique. On parle alors de complexification des génomes.
 Les deux phénomènes sont indissociables pour rendre compte, d’un
point de vue génétique, de l’évolution des êtres vivants avec d’un
coté l’apparition de nouvelles espèces et de l’autre une
diversité des individus d’une même espèce.
Les deux phénomènes sont indissociables pour rendre compte, d’un
point de vue génétique, de l’évolution des êtres vivants avec d’un
coté l’apparition de nouvelles espèces et de l’autre une
diversité des individus d’une même espèce.
|