des phénotypes
L'ensemble des
caractéristiques morpho-anatomiques, physiologiques et comportementales
d'un individu est appelé phénotype. Ainsi son plan d'organisation, sa
taille, sa couleur, son groupe sanguin... constituent-ils des éléments
du phénotype. La variabilité intraspécifique nécessaire aux processus
évolutifs peut être qualifiée de variabilité phénotypique. La
comparaison des phénotypes entre espèces est à la base de la
classification phylogénétique des êtres vivants.
 Les différentes échelles d'étude
du phénotype Les différentes échelles d'étude
du phénotype
Le phénotype peut
se définir aux différentes échelles de l'organisation du vivant. Les
techniques d'observation déterminent alors la nature du phénotype
décrit. La simple observation morpho-anatomique, physiologique ou
comportementale de l'individu donne accès au phénotype macroscopique.
Les techniques fondées principalement sur la microscopie donnent accès
au phénotype cellulaire. Enfin les techniques biochimiques permettent
d'appréhender le phénotype moléculaire.
Les différents niveaux de définition d'un phénotype sont évidemment liés
entre eux. Puisque les molécules interviennent dans les structures et
les activités cellulaires, le phénotype moléculaire conditionne le
phénotype cellulaire. Puisque les organismes sont constitués de cellules
fonctionnant de façon parfaitement intégrée, le phénotype cellulaire a
des répercutions sur le phénotype macroscopique.
 Phénotype, gènes et environnement Phénotype, gènes et environnement
Les gènes codent pour des protéines qui
sont responsables de l'établissement du phénotype. Néanmoins,
l'intervention d'une protéine dans la réalisation du phénotype est
elle même dépendante de facteurs environnementaux. Certains
facteurs de l'environnement peuvent modifier directement le génotype :
la fréquence des mutations peut en effet varier selon la
présence d'agents mutagènes de l'environnement.
Certains facteurs de l'environnement
peuvent modifier un phénotype sans changer le génotype : par
exemple la mutation drépanocytaire du gène de la b
globine donne toujours une hémoglobine anormale HbS. Mais c'est
seulement si la température s'élève, si la concentration en O2
diminue ou par déshydratation que cette hémoglobine se polymérise.
De même , l'existence de gènes
de prédisposition à tel ou tel caractère (par exemple :
apparition du cancer colorectal) est établi par des données
statistiques ou génétiques. Porter un gène qui prédispose à une
maladie donne une plus grande probabilité de développer celle-ci. Mais
cela n'est pas obligatoire : il faut que des facteurs environnementaux
interviennent pour le déclenchement de celle_ci.
Finalement, il apparaît que
l'élaboration d'un phénotype est le résultat de relation complexes
entre gènes et environnement :
-
certains phénotypes ne sont l'expression que d'un
seul gène
-
d'autres caractères viennent de l'expression de
plusieurs gènes
-
des phénotypes apparaissent en fonction de
l'environnement
 Phénotypes et classification
phylogénétique Phénotypes et classification
phylogénétique
 A l'échelle macroscopique
A l'échelle macroscopique
 Organisation interne Organisation interne
|
Le plan d’organisation correspond à l’organisation générale du
corps, c’est à dire la disposition des organes les uns par rapport
aux autres et par rapport aux grands axes du corps (axes de polarité).
Malgré la diversité des organes
observés chez les vertébrés (présence ou absence, forme,
taille…) on remarque que ces organes ont dans les grandes
lignes, la même disposition les uns par rapport aux autres et par
rapport aux axes de polarités : ils ont le même plan d’organisation.
Ces remarquables similitudes des
plans d’organisation des vertébrés illustrent bien qu’ils
ont une origine commune et donc un ancêtre commun.
|
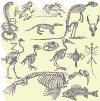 |
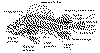 |
 |
 |
 |
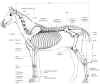 |
| Poisson (carpe) |
Amphibien
(grenouille) |
Reptile
dinosaurien (compsognathus) |
Oiseau (poule) |
Mammifère
(cheval) |
L'observation des squelettes de Vertébrés permet de
constater rapidement des points communs et des différences :
-
ici on constate que les 5 animaux présentés
partagent tous la présence d'une colonne vertébrale
-
tous, sauf le poisson, sont tétrapodes
-
le reptile et l'oiseau ont des squelettes très
ressemblants (forme du bassin...)
Ces constats seront à la base de l'élaboration d'arbres
phylogénétiques symbolisant les divers liens de parenté entre eux.
Des comparaisons concernant
l'architecture générale du squelette interne permet également de
montrer que tous les vertébrés présentent un même plan d’organisation
définit par trois axes de polarité :
-
L’axe antéro-postérieur , passant par la
colonne vertébrale et allant de la tête à la queue.
-
L’axe dorso-ventral , passant du dos au ventre
et perpendiculaire au premier
-
L’axe droite-gauche .
Le corps peut-être divisé en 2 moitiés
semblables, droite et gauche, selon un plan passant par la colonne
vertébrale : le plan de symétrie bilatérale.
 Membres antérieurs des Vertébrés
Membres antérieurs des Vertébrés
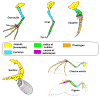
De la même façon il est possible de comparer, non plus
l'organisme dans sa totalité, mais certaines parties de celui-ci. C'est
le cas avec la comparaison des membres antérieurs des vertébrés. On
remarque par ces comparaisons une même organisation générale des
membres (même plan d'organisation).
 Les développements embryonnaires
Les développements embryonnaires
Les Vertébrés possèdent un même plan d'organisation :
celui-ci se met en place au cours de l'embryogenèse.
Malgré des différences importantes, au
début et à la fin du développement, les embryons des vertébrés
passent tous par un stade de développement semblable.
Au sein des vertébrés, les étapes de
développement embryonnaire sont communes (Segmentation, gastrulation,
organogenèse). Il existe donc dans la cellule œuf un programme qui
contrôle le développement pendant lequel apparaît le plan d’organisation :
c’est le programme génétique de développement embryonnaire (sous
commande des gènes homéotiques) qui permet la mise en place des axes
de polarité et du plan de symétrie autour desquels s'organise
l'embryon puis tout l'organisme.
Les mécanismes identiques de
développement embryonnaire témoignent d’une parenté entre les
différents groupes de vertébrés.
 A l'échelle moléculaire
A l'échelle moléculaire
Le phénotype, à l'échelle moléculaire, correspond aux
différentes protéines fabriquées sous la commande d'un programme
génétique : le phénotype d'un organisme est conditionné par les
protéines qu'il possède. les protéines sont des molécules qui
résultent de la transcription puis de la traduction de différents
gènes de l'ADN : ce sont des polymères d'acides aminés organisés en
ce que l'on appelle des "chaînes polypeptidiques" (la liaison
entre chaque acide aminé est une liaison peptidique). L'ordre
d'enchaînement des acides aminés va, en partie, conditionner la forme
spatiale de la protéine associée (la protéines correspond donc à la
chaîne polypeptidique, une fois que cette dernière a acquis une forme tridimensionnelle).
cette structure tridimensionnelle vient des repliements possibles de la
chaîne qui sont la conséquence des liaisons fortes ou faibles que les
différents acides aminés effectuent entre eux.
Il existe une variabilité des phénotypes moléculaires
que l'on nomme des phénotypes moléculaires alternatifs. C'est le cas,
par exemple, de la béta-globine qui présente différentes versions
dont la plupart sont à l'origine de maladies héréditaires graves
(drépanocytose et thalassémies) :
-
une forme "normale" de 146 acides aminés
-
une forme anormale de 146 acides aminés mais dont le
6ième acide aminé est différent (une valine remplace l'acide
glutamique)
-
des formes anormales de 16 à 58 acides aminés au
lieu des 146 attendus)
La forme spatiale des protéines conditionnant leur mode
de fonctionnement (et dans ce cas il s'agit de la majorité des
réactions biochimiques cellulaires), des variations de phénotypes
moléculaires engendrent des modifications de phénotypes cellulaires et
macroscopiques.
Parce que les protéines présentent des séquences en
acides aminés(et donc comparables entre elles), qu'elles sont une
expression du génotype (et donc associées à l'hérédité) et
qu'elles présentent à la fois des différences et des ressemblances,
ce matériel sera utilisé pour retrouver des liens de parenté.
Remarque : on parlera de molécules homologues s’il
y a similitude des séquences : il faut au moins 20% de similitude des
séquences pour pouvoir effectuer des "liens de parenté"
entre ce type de molécules.
|